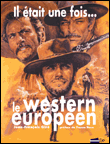Le colt cantarono la morte et fu… tempo di massacro
1966
Lucio Fulci
Avec : Franco Nero, George Hilton
Un péon est lâché dans la nature pour être immédiatement poursuivi par une horde de chiens et de gueules patibulaires. Normal, c’est un péon, corri uomo corri, et comme dans la vraie vie, le faible se fait bouffer dans une curée extatique. Les esprits chagrins se demanderont ce que fait un péon mexicain dans une nature verdoyante aussi typiquement italienne. Les esprits contemporains remarqueront que décidément, ces chiens sont bien longs à rattraper le type. Les esprits comme il faut dénigreront une scène à la cruauté purement gratuite, sans même une pseudo-excuse de continuité narrative. Cette mort ne sera en effet sans conséquence aucune dans la suite des évènements. Les esprits spaghetti au contraire, apprécieront qu’il n’y ait pas de héros pour sauver le malheureux, car dans le western spaghetti, l’expression de la violence passe d’abord par une cruauté démesurée de la part des méchants.
Ensuite, les racines du mal œdipien se mettent en place tranquillement sous une musique pas encore tout à fait débarrassée des tics du western américain. L’imagerie elle, est parfaitement raccord : ville délabrée, figurant qui mène un cochon, vils salopards qui jouent aux dés et Tom Corbett (Franco Nero) dans sa vareuse noire au beau milieu d’une rue qui se vide de ses habitants. Le méchant à gueule d’homo refoulé (Nino Castelnuovo) se trouve de nouvelles victimes et le massacre peut commencer. Ville terrorisée, familles désespérées, poids des non-dits et de la peur, Tom Corbett reste plus ou moins passif le plus longtemps possible, le temps d’abord de retrouver son frère devenu alcoolique (George Hilton) et de parler à Carradine qui passe à l’as illico ainsi que sa famille. Hoo bien sûr, on le met en garde Corbett, il va arriver un malheur, regarde, il y a Aysanoa Runachagua qui nous surveille du haut de la colline, ça, c’est forcément des ennuis en perspective, et puis le méchant joue du clavecin ou de l’orgue, attention !!
Malheureusement, les frères Corbett ne sont pas de simples péons, ni des petits paysans, on ne peut pas les donner simplement à bouffer aux chiens : intimidations, passage à tabac, alcool sur les plaies, séquences de fouet traumatisante, meurtre de la vieille nourrice, il faut ce qu’il faut pour décider nos deux lascars à enfin se bouger et nous décimer tout ça dans les règles, révélations familiales dans l’estomac !
Film clé dans la période sombre du western spaghetti, Le temps du massacre se démarque de certains de ses cousins tels Texas Addios par un ton extrêmement sec et inhumain dû à la personnalité sans concession du réalisateur Lucio Fulci. Il n’échappe pas non plus au ridicule de certaines situations (l’adresse irréaliste du frère de Scott alors qu’il est sous l’emprise de l’alcool, certaines pirouettes du combat final), ni au sentiment rétrospectif de déjà vu après que bon nombre de westerns (et pas toujours des moindres : Le dernier des salauds, Johnny Hamlet, Keoma, Mannaja) exploreront la même trame scénaristique désormais éculée. Malgré tout, Le temps du massacre est un western particulièrement réussi, avec une interprétation sans faille de l’ensemble des habitués du genre (y compris George Hilton, qui donne à son personnage un certain recul bienvenu) et un premier degré dramaturgique assumé propre à faire frissonner les plus blasés d’entre nous ! Ainsi lorsque Franco Nero annonce « Je reviendrai ! », ainsi, lorsque George Hilton se décide enfin à empoigner sa winchester, ainsi lorsqu’il devient clair que le massacre devient la seule voie de sortie, l’esprit du western spaghetti bat son plein. A la fin tout le monde est mort ou presque – comme il se doit – mais au moins, les non-dits et les secrets se sont exprimés de la façon la plus spectaculaire qui soit.
Le DVD Studio Canal : service minimum, image non restaurée, VF seulement, jaquette hideuse : le marché du DVD perd ses parts de marché et s’enterre lui-même. Si on est heureux de posséder un DVD Neo Publishing réalisé avec soin, quel gain avons-nous à acheter ces DVD mal foutus ? On en serait presque à préconiser le téléchargement dans des cas comme celui-ci. Mais c’est marqué au début du DVD : c’est interdit !!!